Le texte qui suit est un extrait d’un projet de recherche déposé au FNRS pour financement en 2021. Comme il peut intéresser d’autres personnes que les experts évaluateurs, je le publie sur ce carnet.
État de l’art
L’histoire du jeu vidéo a été dominée jusqu’à la fin des années 2000 par deux points de vue, liés aux personnes (journalistes ou chercheurs) qui l’ont écrite : un regard américain sur une histoire américano-centrée et un regard occidental sur la production japonaise, principalement sous l’angle de l’importation (voir notamment Herman 1994; Herz 1997; Van Burnham 2001; Kent 2001; Wolf 2007 et 2012; Blanchet 2010; Donovan 2010; Ichbiah 2011; Audureau 2014).
Pourtant, au cours des années 2010, de multiples initiatives émanant de différents pays sont apparues pour ébranler et remettre en question ce récit historique trop établi. La sortie de l’important ouvrage de Blanchet et Montagnon en 2020 sur l’histoire du jeu vidéo en France illustre parfaitement ce point : il est inconcevable, si l’on veut comprendre l’émergence d’un produit culturel, de limiter son histoire à ses réussites commerciales. Or, le développement du jeu vidéo, dans toutes ses composantes (commerciales, amateures, éducatives, associatives), peut être décrit sur un modèle réticulaire international, multipliant les noeuds et les connexions entre ces noeuds, parfois assez improbables (on pense à l’importance du réseau européen de l’énergie atomique lors de sa préhistoire par exemple).
Le travail a déjà commencé dans d’autres pays : Jaroslav Švelch, avec son livre Gaming the Iron Curtain. How Teenagers and Amateurs in Communist Czechoslovakia Claimed the Medium of Computer Games (2018), a mis en exergue d’autres logiques historiographiques pour souligner l’existence et les spécificités du jeu vidéo durant la fin de la Guerre froide du côté communiste. L’UNIL Game Lab, à Lausanne, a commencé un travail bibliographique important (Rochat 2020), recensant les publications sur l’histoire internationale du jeu vidéo, notamment les histoires non hégémoniques. De nombreux chercheurs se sont intéressés au jeu vidéo éducatif et au serious game (Djaouti 2011), au jeu vidéo associatif et citoyen (Neys et Jansz 2019), au jeu vidéo protestataire (Bashandy, Hallot et Dozo 2020), avec une dimension historiographique. Un intérêt prégnant pour les histoires locales et non hégémoniques s’impose dans les principaux centres et réseaux de recherche en game studies : le livre édité par Mark J.P. Wolf, Video Games Around the World (2015), fonctionnant comme une encyclopédie des histoires locales du jeu vidéo, l’illustre bien. Fait cependant révélateur : il ne comprend pas d’entrée pour la Belgique…
Pourtant, les sources existent : des archives personnelles des premiers créateurs commercialement reconnus (le studio Appeal, concepteur d’Outcast en 1999) aux clubs amateurs faisant vivre les machines jalonnant l’histoire belge du jeu vidéo (comme la DAI Imagination machine, datant de 1977), il existe une multitude de sources accessibles, non exploitées et d’un grand intérêt pour l’histoire du jeu vidéo belge. Nous sommes également à un moment où il est encore possible de trouver des témoins directs de toutes les époques de cette histoire, même si les acteurs des années 1950 et 1960 commencent à disparaître. Nous pensons donc qu’il existe en 2020 un momentum pour écrire l’histoire du jeu vidéo en Belgique.
Projet de recherche
L’intérêt d’écrire cette histoire aujourd’hui n’est pas seulement lié à une contingence temporelle : le jeu vidéo, par l’évolution rapide de son statut et de sa légitimité, par la place importante qu’il occupe au sein des industries culturelles et créatives, doit être mieux connu pour comprendre ses enjeux économiques, culturels et éducatifs régionaux et nationaux. Par ailleurs, on sait qu’à d’autres endroits (pour citer deux exemples bien connus : au Québec et en Finlande), il a pu constituer un vecteur de développement économique à haute valeur ajoutée. Mieux connaître son histoire nationale permettra d’évaluer la pertinence des politiques publiques de soutien qui voient actuellement le jour (voir par exemple à ce propos l’extension du mécanisme du Tax Shelter, qui fait question au niveau européen).
Un troisième intérêt justifie ce projet, celui-là lié à la recherche fondamentale : le jeu vidéo est un objet posant de nombreuses questions à l’historiographie des produits culturels. Produit hybride et collectif par excellence, il demande au chercheur de se positionner théoriquement sans écraser les multiples dimensions de l’objet. Ainsi, la conception dominante concernant l’hybridité est celle de Kline, Dyer-Witheford et De Peuter (2003), qui proposent de prendre en compte les sphères technique, marketing et culturelle. Bien que louable dans son effort de rendre compte de l’hybridité de l’objet, cette conception ignore les enjeux sociaux, politiques, linguistiques et genrés, pour citer ceux qui sont examinés, en plus de ceux de Kline & alii, au sein de notre projet. Du côté de la dimension collective, il faut souligner que le jeu vidéo est un produit collaboratif à plusieurs niveaux, mais que ces niveaux doivent être pondérées. Premier exemple : rares sont les jeux commerciaux produits par un seul créateur ; pourtant, la scène amateur regorge de créations individuelles. Deuxième exemple : jouer actualise la proposition créative du concepteur ; on pourrait dire que le jeu n’est réellement actualisé que lorsqu’on y joue. D’où la reconnaissance de deux groupes d’intervenants : les créateurs, du côté du pôle de production, et les joueurs (qui peuvent aussi devenir professionnels, comme dans la scène e-sport), du côté du pôle de réception. Pourtant, un certain courant de la recherche actuelle insiste sur la dimension de co-construction des univers fictionnels qui prennent naissance dans les jeux (fan fictions, fan arts, etc.), donc l’opposition créateur/récepteur est aussi à questionner. Enfin, troisième exemple : la culture vidéoludique est un moyen utile de socialisation pour les enfants dans les cours de récréation ; nombre de jeux se jouent en ligne, au sein de larges communautés. Pourtant, le jeu vidéo traîne toujours avec lui une image médiatique de loisir qui isole, transformant le jeu en outil de repli sur soi. Toutes ces paradoxes apparents demandent au chercheur de se positionner sur un ensemble de points théoriques et méthodologiques liés à l’historiographie qu’il veut pratiquer. Ainsi, écrire l’histoire du jeu vidéo en Belgique pose une série de questions spécifiques, articulées à des définitions de la pratique ludique et des objets dont on entend faire l’histoire.
Pour ce projet, nous retenons trois hypothèses d’où découlent notre cadre théorique et méthodologique. La première est que le champ vidéoludique belge lie étroitement développement logiciel (software) et innovation technique et technologique (hardware et software). Cette hypothèse a pour conséquence d’inscrire cette recherche dans une histoire sociale des biens culturels, telle que la sociologie de la littérature a pu la développer (Bourdieu 1992; Dubois 1978), avec une dimension forte d’histoire des techniques inspirée de l’histoire du livre. Quatre exemples permettent de nourrir cette hypothèse : tout d’abord, citons le cas de la DAI Imagination machine évoquée plus haut, qui était un ordinateur belge datant de 1977 et disposant de nombreuses possibilités graphiques et musicales propres à créer des jeux vidéo, dont la distribution était assurée par des listings dans les journaux des clubs locaux liégeois, bruxellois et carolorégien. Ensuite, évoquons les nombreux moteurs de jeu dédiés, développés par les jeunes studios des années 1990 et 2000 (de Appeal à Elsewhere en passant par Larian Studios). Ces logiciels étaient indispensables à la création d’un jeu et pouvaient être réutilisés de projet en projet. Terminons par deux projets contemporains : Softkinetic, société bruxelloise, a développé entre 2007 et 2010 une caméra-senseur 3D, concurrente du Kinect de Microsoft. Ce senseur était accompagné d’une série de jeux visant à démontrer l’intérêt du matériel. Ils ont été rachetés par Sony en 2016. Autre projet contemporain à dimension internationale : le Terragame est un parc de loisir situé au départ à Spy, dédié à la réalité virtuelle et créé en 2016. Ordinateur sur le dos et casque sur les yeux, les joueurs se déplacent physiquement dans un espace vide qui devient tout univers fictionnel en fonction du jeu proposé. Au départ dépendant d’une sous-traitance lyonnaise, la société a internalisé le développement de jeu pour suivre plus facilement les innovations techniques du matériel.
La deuxième hypothèse est qu’il a existé et qu’il existe des lieux de sociabilité spécifiques belges autour du jeu vidéo, fondés sur une culture numérique et ludique. Ces lieux prennent différentes formes (clubs, sociétés d’amis, etc.) mais la diffusion d’internet dans le grand public a permis une multiplication de ces lieux et parfois la résurrection virtuelle de communautés anciennes. Cette hypothèse nécessite la mobilisation des humanités numériques et des sciences de l’information et de la communication pour étudier ces sociabilités numériques, sur le modèle de Cassili (2010) notamment. L’exemple par excellence de ces lieux d’interrelations, qui aideront à fixer et diffuser une culture vidéoludique spécifique, est Parano (www.parano.be), un site web héritier de l’esprit des BBS (Bulletin Board Systems) des années 1990, fonctionnant sur la cooptation et s’inspirant dans son fonctionnement des règles du jeu de rôle cyberpunk Paranoïa (West End Games, 1984). L’exemple est particulièrement révélateur car il est en partie réflexif, utilisant des règles de jeu pour structurer une sociabilité autour du jeu.
Enfin, la troisième hypothèse concerne la définition du champ de production vidéoludique belge : vu la faible structuration professionnelle du champ en Belgique, il existe des liens fondamentaux entre les amateurs et les professionnels, avec une fluidité de frontières qui demande à redéfinir le champ de production vidéoludique belge sur des critères autres que des critères de professionnalisation ; par exemple ceux des compétences et de la participation à des projets (Hurel 2020). Les lieux de rencontre locaux (Apéro du jeu vidéo à Liège, Brotaru à Bruxelles) l’ont bien compris et s’ouvrent aux non-professionnels. Même les studios établis ne peuvent être définis par leur création porte-étendard : nombreux sont ceux qui survivent grâce aux portages d’un système de jeu vers un autre pour le compte d’autres développeurs. D’autres se tournent vers le développement de logiciels de jeu éducatifs, dont on connaît encore mal les ramifications mais qui entretiennent des liens forts avec le milieu de l’enseignement et des ministères (enseignement et culture).
Une attention particulière sera portée aux questions linguistiques propres à la Belgique (quels sont les contacts entre la Flandre et la Wallonie ? peut-on parler d’un champ de production belge unique ? les politiques publiques culturelles ont-elles créé des clivages entre Régions ?) et aux questions de genre : on sait que l’invisibilisation des femmes dans l’histoire du jeu est en partie due à l’inattention portée à leur présence par ceux qui racontent l’histoire, ce que nous souhaitons absolument éviter.
Nous disposons déjà des relais utiles pour mobiliser les sources nécessaires à l’exploration de ces trois hypothèses. Nous souhaitons néanmoins faire un pas de plus dans la conservation des sources de cette histoire, en tentant de convaincre nos informateurs de la pertinence de nourrir par leurs archives le fonds d’archives « Culture vidéoludique » (voir la description dans la partie environnement de recherche du promoteur principal).
Bibliographie (par ordre alphabétique)
Audureau William, 2014. Pong et la mondialisation, Toulouse, Pix’n Love.
Bashandy Hamza, Hallot Pierre et Dozo Björn-Olav, « Jeux vidéo et protestations civiques et politiques », Géographie et cultures, 109 | 2019, 75-97, http://journals.openedition.org/gc/10034.
Blanchet Alexis et Montagnon Guillaume, 2020. Une histoire du jeu vidéo en France. 1960-1991 : des labos aux chambres d’ados, Toulouse, Pix’n Love.
Blanchet Alexis, 2010. Des pixels à Hollywood, Toulouse, Pix’n Love.
Bourdieu Pierre, 1992. Les règles de l’art, Paris, Seuil.
Cassili Antonio, 2010. Les liaisons numériques, Paris, Seuil.
Denis Brigitte, 2000. « Vingt ans de robotique pédagogique », Sciences et techniques éducatives, vol. 7 n°1.
Djaouti Damien, 2011. Considérations théoriques et techniques sur la création de jeux, Thèse de doctorat, Université Toulouse III Paul Sabatier.
Donovan Tristan, 2010. Replay. The History of Video Games, Lewes, Yellow Ant.
Dubois Jacques, 1978, L’institution de la littérature, Bruxelles, Labor.
Herman Leonard, 1994. Phoenix: The Fall & Rise of Video Games.
Herz J.C., 1997. Joystick Nation: How Videogames Ate Our Quarters, Won Our Hearts, and Rewired Our Mind.
Hurel Pierre-Yves, 2020. L’expérience de création de jeux vidéo en amateur – Travailler son goût pour l’incertitude, Thèse de doctorat en Sciences de l’Information et la Communication, Université de Liège, sous la direction de Christine Servais.
Ichbiah Daniel, 2011 (5e éd.). La Saga des jeux vidéo, Toulouse, Pix’n Love.
Kent Steven, 2001. The Ultimate History of Video Games: From Pong to Pokemon.
Kline Stephen, Dyer-Witheford Nick et De Peuter Greig (2003), Digital Play. The Interaction of Technology, Culture, and Marketing, Montréal & Kingston – London – Ithaca, McGill-Queen’s University Press, 2003.
Neys Joyce et Jansz Jeroen, 2019. “Engagement in play, engagement in politics: Playing political video games”. In Glas René et al., The Playful Citizen: Civic Engagement in a Mediatized Culture.
Rochat Yannick & UNIL Game Lab (ed.), 2020. Game historiography. A bibliography, Zotero, https://www.zotero.org/groups/2445242/game_historiography/library.
Švelch Jaroslav, 2018. Gaming the Iron Curtain. How Teenagers and Amateurs in Communist Czechoslovakia Claimed the Medium of Computer Games, Cambridge, MIT Press.
Van Burnham, 2001. Supercade: a Visual History of the Videogame Age.
Wolf Mark J.P. (2015), Video Games Around the World, Cambridge, MIT Press.
Wolf Mark J.P. (ed.), 2007. The Video Game Explosion: A History from Pong to Playstation and Beyond.
Wolf Mark J.P. (ed.), 2012. Before the Crash.





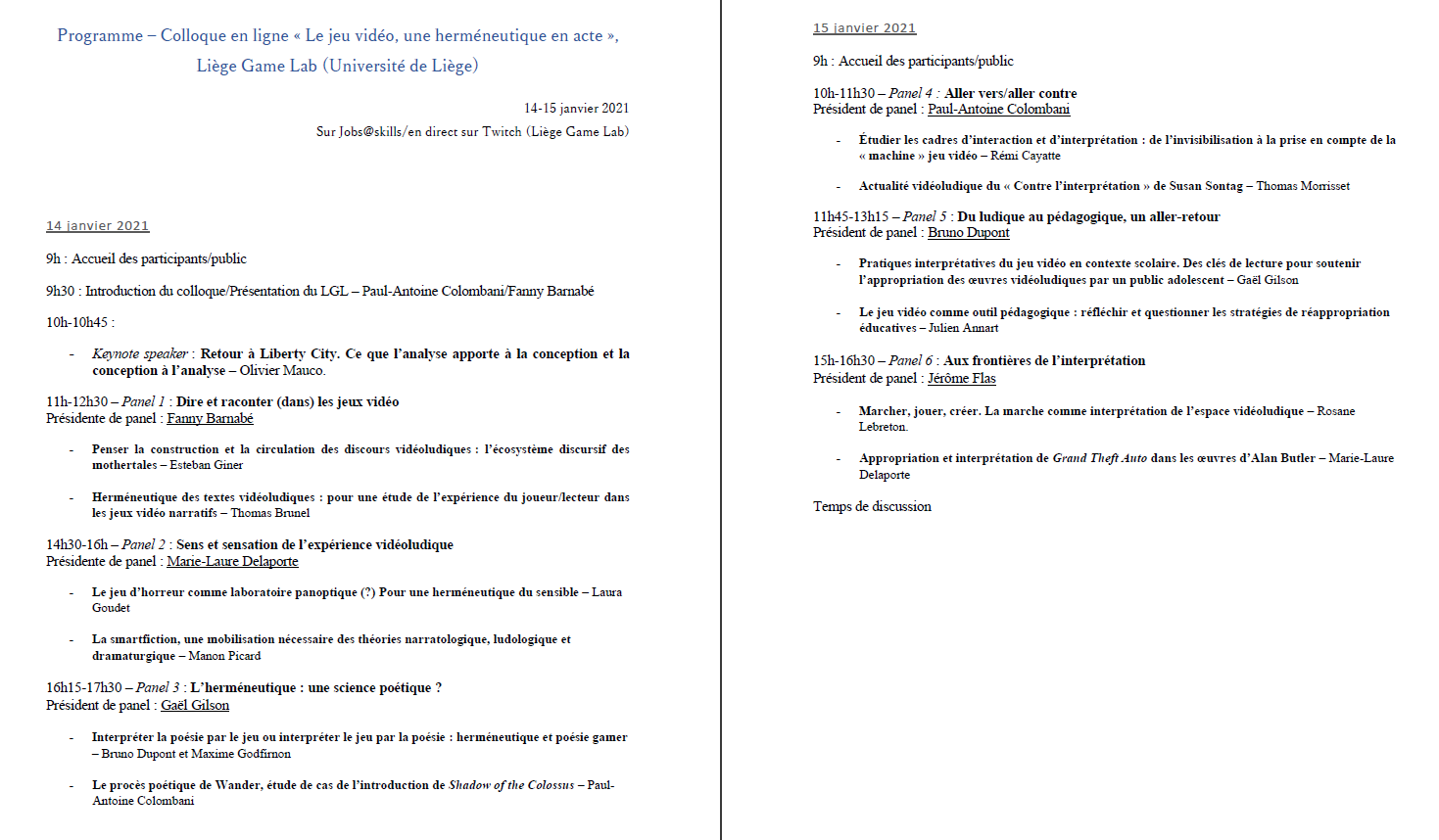



 À propos
À propos