Ceci est une trace de ma brève communication à la journée d’étude des Fortnite Studies, qui eut lieu à Lausanne le 15 mars 2019. Le texte devrait être revu pour publication : les récents événements (comme les concerts de Travis Scott) me semblent aller dans le sens que je défendais.
Début de partie : des menus partout, du plaisir nulle part
L’idée de tenter de penser Fornite comme la partie visible
d’une plateforme numérique est née de ma faible expérience de jeu. Errant dans
les menus, patientant devant les écrans de chargement, je me suis demandé
pourquoi c’était si long et si foisonnant. Pourquoi cette relative opacité ?
Quels codes régissent cette interface, ces menus, ces options essentielles ou
cosmétiques ? Plus largement, quel intérêt à cette multiplication de possibles ?
Le novice que je suis est désemparé face à toutes ces
options et ne sait pas faire la différence entre le cosmétique et l’essentiel.
Je me laisse guider par le prix des choses : ce qui est payant doit être
accessoire pour ma pratique, étant donné que pour gagner à Fortnite, il n’est
pas nécessaire de sortir sa carte de crédit. Néanmoins, si ce qu’on peut
acheter, comme les emotes, les skins, les danses, est accessoire pour ma
pratique de débutant, il constitue aussi (surtout) les signes extérieurs
d’appartenance à une communauté, d’intégration au sein d’un écosystème coloré
et dans l’air du temps. Ce n’est donc pas accessoire pour tout le monde.
L’enjeu est justement d’en comprendre le code, de pouvoir en parler, d’échanger
avec ses amis, d’exhiber ses derniers achats à défaut de se vanter de son
dernier « top 1 ». Enfin, toutes ces améliorations cosmétiques sont
aussi autant de traces de son propre investissement dans le jeu, dans son univers.
Signes du temps et de l’énergie qu’on y a consacrés.
Ces menus concernent donc le joueur. Mais concernent-ils le
jeu ? Mon expérience du jeu sera-t-elle différente si je consacre beaucoup
de temps à ces menus ou si je me concentre sur le jeu lui-même ? Du point
de vue d’Epic Games, l’éditeur, cette question n’est pas centrale. Car
finalement, l’hypothèse est que le jeu lui-même est secondaire.
Fortnite, une plateforme numérique comme les autres ?
Toutes ces options (améliorations cosmétiques, championnats,
défis, saisons) prennent sens si on considère Fortnite non pas comme un jeu,
mais comme une plateforme, au même titre que Facebook, Uber, Deliveroo ou
Amazon. Il s’agit donc de montrer que comme toutes les autres plateformes, Fortnite
doit conserver l’utilisateur actif pour grossir. Pas seulement pour le faire
consommer directement (via les transactions au sein du jeu), mais aussi pour le
faire produire des données. C’est à mon sens le cœur de Fortnite.
Qu’est-ce qu’une plateforme ? Dans Platform Capitalism, Nick Srnicek la définit comme suit :
« une plateforme est une infrastructure numérique qui met en relation au
moins deux groupes d’individus »[1].
Christophe Benavent, dans son ouvrage Plateformes,
envisage l’idée de la plateforme de la sorte : c’est « un dispositif
qui coordonne les actions et les ressources de la foule, l’expression d’une
demande, des disponibilités, du travail, des biens. Les plateformes sont
constituées par un ensemble d’inventions techniques et sociales qui permettent
des gains consistants de productivité dans la coordination d’une multitude de
microactivités »[2].
Retenons déjà de ces deux définitions l’idée de numérique, d’interactions et de
relations sociales et d’optimisation des ressources.
Antonio Casilli, dans un brillant essai sur les écosystèmes
des travailleurs numériques, consacre un chapitre important à la question des
plateformes[3].
Il commence par proposer une lecture politique de l’émergence historique du
concept de plateforme, dont la genèse des traits politiques définitoires qu’il
isole permettrait sans doute de proposer une lecture politique de Fortnite dans
une chaîne de continuité historique. Mais avant qu’il ne soit même possible de
proposer ce type d’analyse, il faut montrer en quoi Fortnite est une
plateforme. Dans ce but, une série de caractéristiques mises en avant par
Casilli pour qualifier les plateformes numériques seront mobilisées , afin
d’éprouver jusqu’à quel point il est possible de penser Fortnite avec
celles-ci.
Des mécanismes multiface
Tout d’abord, les plateformes, pour Casilli, « se
construisent comme un type particulier de mécanismes multiface ». Il prend
l’exemple de Youtube, « qui a plusieurs catégories d’usagers : des
usagers-annonceurs qui s’acquittent d’un prix positif, des usagers-spectateurs
qui paient un prix nul et des usagers-youtubers qui ont, eux, un prix négatif
(c’est-à-dire qu’ils sont parfois rétribués pour leur usage de la
plateforme » (p. 64). De la même manière, Fortnite différencie aussi
les catégories d’usagers ; cependant, leurs rôles évoluent au cours de la
partie et leur implication diffère. Il en résulte une typologie plus complexe. À
mon sens, on peut différencier au moins six types :
- les usagers joueurs payants du jeu original en
PvE (player vs environment), qui continue à exister malgré le lancement du
battle royale (PvP) à qui Fortnite doit son succès exceptionnel ;
- les usagers joueurs utilisant la version battle
royale (PvP), gratuites pour les fonctions de jeu ;
- les usagers joueurs achetant des modifications
cosmétiques pour le battle royale ;
- les usagers joueurs esportifs, qui peuvent
gagner de l’argent grâce à leurs compétences en jeu ;
- les usagers spectateurs ;
- les usagers joueurs producteurs qui enregistrent
leurs parties et les diffusent sur des plateformes extérieures.
Il faut évoquer plus spécifiquement les usagers spectateurs,
que Julie Delbouille nomme des joueurs secondaires[4],
qui soit regardent la partie qui se termine quand ils ont été éliminés, soit regardent
des parties en direct ou en différé sur d’autres plateformes (Twitch ou
Youtube), afin d’améliorer leur compréhension du jeu ou de profiter de belles
actions (comme on le fait en sport). Au sein du jeu, la construction du joueur
secondaire est très importante, car quand on meurt, on voit à travers le point
de vue de l’avatar qui vous a tué (ou du plus proche si vous êtes assez
maladroit pour mourir tout seul). Un sentiment ambigu, fait d’attachement, de
frustration et de résignation, se crée autour de ce point de vue : c’est à
cause de cet avatar que vous ne jouez plus, mais si c’est lui qui gagne, une
pointe de satisfaction pourrait naître du fait de s’être fait éliminé par le
vainqueur. Ce choix technologique, qui n’est pas propre à Fortnite (on le
retrouve dans la plupart des jeux de tir compétitifs à la première personne),
induit des modalités de participation demandant une implication plus ou moins
grande, et facilite la transition entre ces modalités.
On constate donc que Fortnite est un mécanisme multiface
(plusieurs types d’usagers à différents coûts pour la plateforme), sur lequel
d’autres mécanismes multiface peuvent se greffer (Youtube et Twitch sont les
plus évidents pour retransmettre des vidéos, mais d’autres mécanismes multiface
pourraient exister, comme les organisateurs de tournoi e-sportifs, qui
supportent les prix négatifs (des récompenses sont aussi possibles par des
organisateurs de tournoi hors Fortnite) et peuvent tirer profit des prix
positifs (comme les inscriptions à la compétition). Du point de vue économique
et participatif, Fortnite est donc bien une plateforme.
Un fonctionnement grâce aux données utilisateurs
La deuxième caractéristique des plateformes que Casilli
pointe concerne l’appariement algorithmique entre différentes catégories
d’usagers. Il cite comme exemple la régie Doubleclick de Google, qui collecte
massivement les données des utilisateurs « pour les transmettre à des
plateformes d’enchères en temps réel, qui, à leur tour, vendront chaque clic à
l’annonceur qui paiera le meilleur prix » (p. 64-65). C’est peut-être
la caractéristique la plus évidente de Fortnite : le principe même du mode
battle royale est de se faire rencontrer une centaine de joueurs, appariement
fondé sur leur co-présence en ligne et potentiellement sur d’autres paramètres
ludiques et techniques (expérience des joueurs, proximité des serveurs, etc.).
Ces usagers sont qualifiés par une série de données, qui sont elles-mêmes
utilisées pour apparier les joueurs. Privilégier la présence synchrone est un
trait distinctif de Fortnite par rapport à d’autres plateformes, même si
d’autres plateformes peuvent y recourir (Messenger de Facebook par exemple) [ou
si Fortnite permet aussi de profiter de l’expérience ludique autrement
(replays]. Les données produites par les usagers sont aussi utilisées par Epic
Games pour optimiser l’usage de la plateforme : on sait que l’éditeur est
très attentif aux retours directs de certaines franges de sa communauté (via
des subreddits spécifiques notamment), mais ce n’est pas le seul retour sur
lequel ils se fondent : les données de jeu, les usages des joueurs sont au
cœur du dispositif d’optimisation de l’outil.
Une captation de la valeur produite par les utilisateurs
Enfin, le troisième trait caractéristique des plateformes
pour Casilli « renvoie au processus de captation par les plateformes de la
valeur produite par leurs utilisateurs » (p. 65).
Cette appropriation à partir des écosystèmes d’acteurs qu’elles engendrent peut être représentée par les masses de données nécessaires au fonctionnement d’un moteur de recherche comme Bing, par les commissions sur les biens échangés par les artisans de la plateforme de commerce Etsy ou encore par les photos prises par les membres de Flickr et monétisées par ce service. Ainsi faisant, les plateformes brouillent les frontières entre intérieur et extérieur de la firme, entreprennent de complexes arbitrages entre « logiques ouvertes » et enfermement propriétaire, et se présentent comme des entités nouvelles, à mi-chemin entre marché et entreprises.[5]
Antonio A. Casilli, En attendant les robots. Enquête sur le travail du clic, Paris, Seuil, coll. « La Couleur des idées », 2019, p. 65.
Dans le cas de Fortnite, la capitalisation se fait sur
plusieurs fronts : des vidéos commentées aux compétitions e-sportives, des
fanarts aux personnalisations de skins, les options sont nombreuses pour
impliquer le joueur au-delà du jeu. L’objectif n’est pas tant de faire jouer
que de faire vivre l’univers fictionnel. La succession des saisons, qui
rebattent les cartes et demandent un réinvestissement même du joueur le plus
aguerris, les objets qui apparaissent dans la boutique pour un temps limité,
tout pousse à revenir au jeu, à en découvrir toujours plus les petites
innovations, à nourrir le métajeu. Fortnite n’est pas seulement le lieu du jeu,
il est avant tout le lieu de la rencontre à propos du jeu.
Quel intérêt de qualifier Fortnite de plateforme ?
Une fois établi que Fortnite n’est pas qu’un jeu mais plutôt
une plateforme dont le modèle économique réside sur la captation des données
des utilisateurs et de la valeur produite par ceux-ci, qu’est-ce que cela
apporte à l’analyse ?
D’une part, cela permet de comprendre la logique des menus
encadrant le jeu. Ceux-ci sont là pour multiplier les expériences ludiques et
paraludiques potentielles et renouveler l’attention vacillante du joueur.
D’autre part, et ça me paraît plus important, cela permet
d’expliquer d’autres comportements liés à Fortnite. Comme l’expliquait
Pierre-Yves Hurel dans l’article journalistique évoqué précédemment, « le
romancier Keith Stuart comparait Fortnite à un skatepark : c’est un
tiers-lieu où les gens se retrouvent et discutent ». Or cet usage, assez
commun, n’est possible que parce que Fortnite est une plateforme, et pas
seulement un jeu : il crée lui-même les conditions de son
détournement ; il propose, dans une tension propre aux plateformes comme
cité plus haut, un complexe arbitrage « entre “logiques ouvertes”
et enfermement propriétaire ». Il offre aussi, et cela me semblait utile
de le préciser dans les premières communications de cette journée d’étude, les
saillances et les usages multiples et diversifiés nécessaires à la construction
interdisciplinaire d’un objet d’étude. Ce n’est pas un hasard si Fortnite est
l’un des premiers jeux auquel on consacre une journée d’étude, car à mon sens,
et j’espère avoir pu vous en convaincre, Fortnite déborde le cadre ludique,
tout en le remplissant par ses mécaniques. Il propose une expérience totale,
faite de fun, de compétition, d’échanges sociaux, de commerce et de production
de données.
[1] Nick Srnicek, Platform Capitalism, Cambridge, Polity Press, 2007, cité par
Casilli, p. 63.
[2]
Christophe Benavent, Plateformes. Sites
collaboratifs, marketplaces, réseaux sociaux… Comment ils influencent nos choix,
Éditions FYP, 2016. 22
[3]
« De quoi une plateforme numérique est-elle le nom ? », dans
Antonio A. Casilli, En attendant les robots. Enquête sur le travail du clic,
Paris, Seuil, coll. « La Couleur des idées », 2019, p. 63-91.
[4] Julie Delbouille, Négocier avec une identité jouable. Les processus d’appropriation et de distanciation entre joueur, avatars et personnages vidéoludiques, thèse de doctorat en Information et Communication, dir. Christine Servais et Björn-Olav Dozo, Université de Liège, 2019.
[5]
Antonio A. Casilli, En attendant les robots. Enquête sur le travail du clic,
Paris, Seuil, coll. « La Couleur des idées », 2019, p. 65.
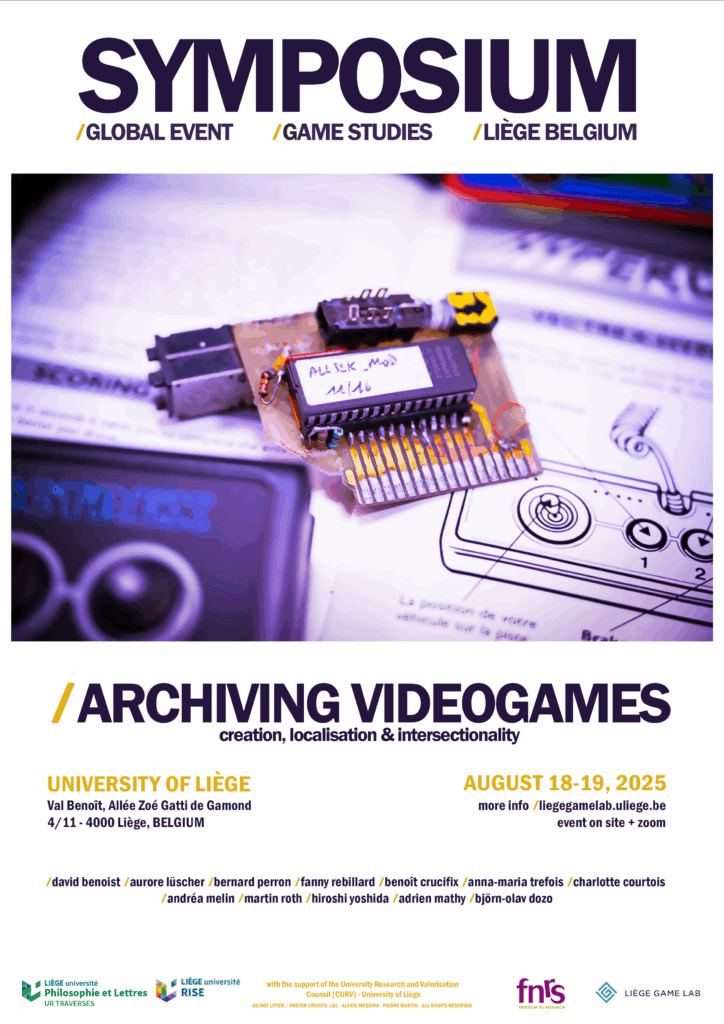
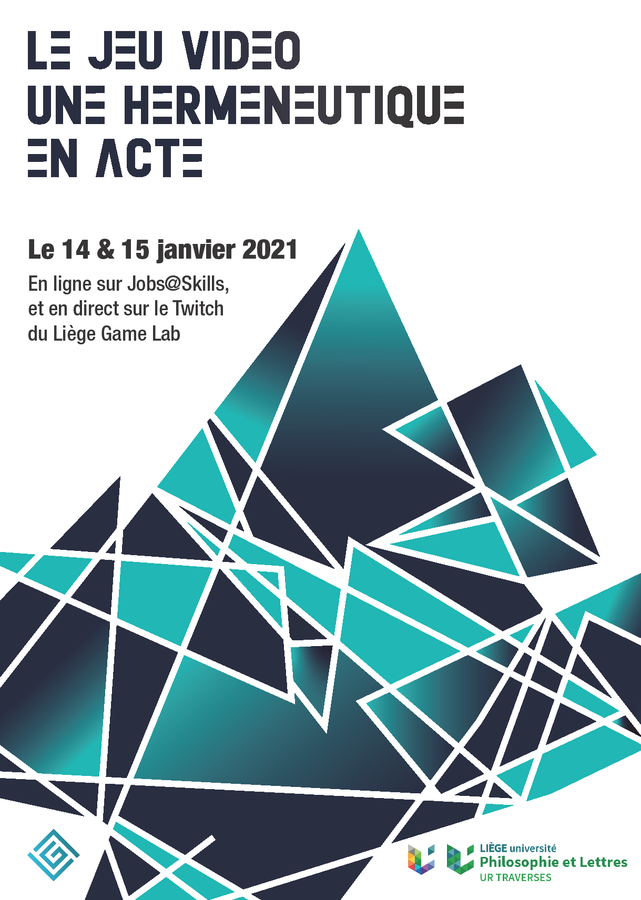
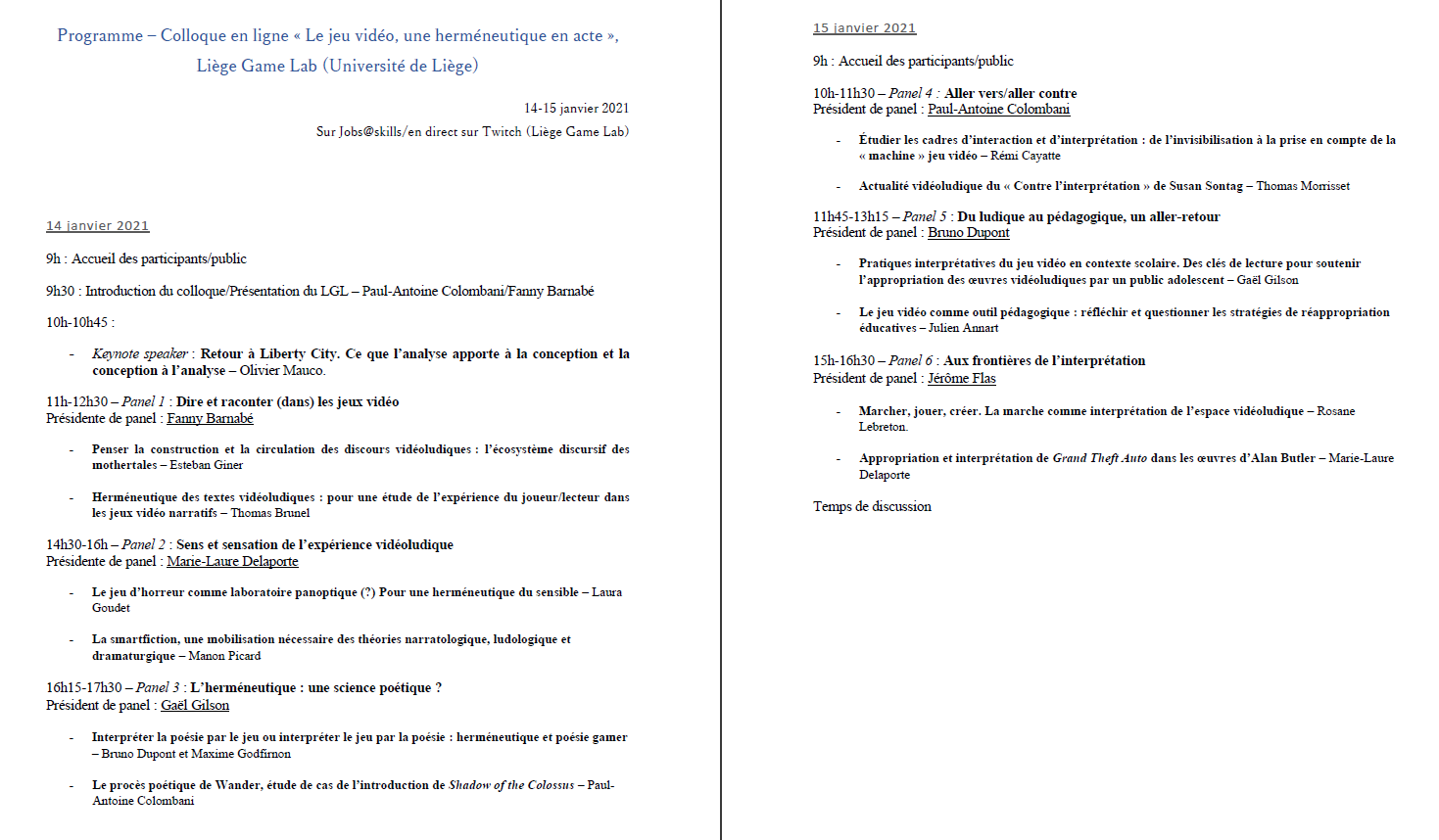

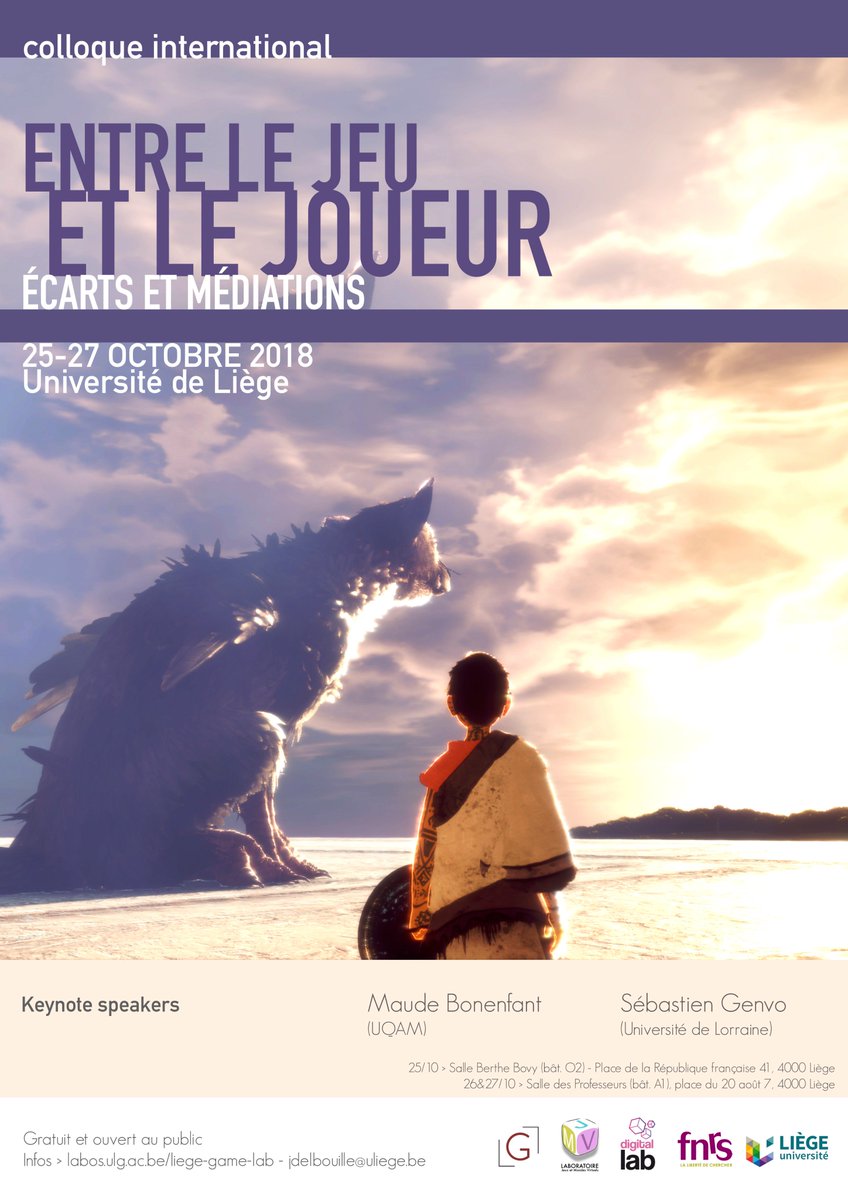


 À propos
À propos